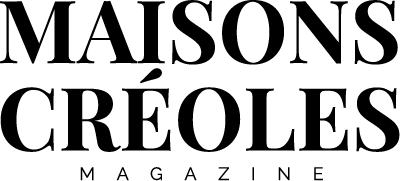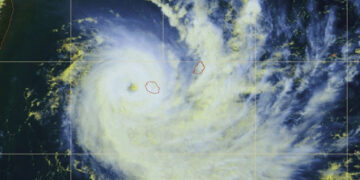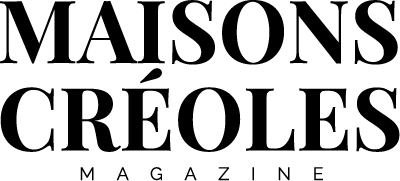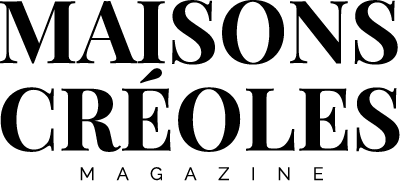Le fer, matériau impérieux et de caractère, s’est installé en puissance dans l’histoire des colonies, jusqu’à devenir incontournable dans les îles à partir de la moitié du XIXe siècle. Et pour en dompter les caprices, une caste particulière d’artisans s’est développée en Guadeloupe et Martinique, celle des maîtres du métal, parmi lesquels les ferronniers d’art.
Les premiers ferronniers de l’île
La ferronnerie, parmi tous les métiers du métal, est celui qui se dédie à un travail du fer, à chaud ou à froid, à l’aide d’une forge, d’une étampe à poinçonner ou d’un marteau, afin de produire des éléments de bâti ou des outils particuliers : bêches et socs, garde-corps, escaliers, grille ou verrou… La variété des techniques permet aux ferronniers de pratiquer, aux Antilles, avec des matériaux et emprises limitées, dont les seuls enjeux seront la complexité et la qualité des ouvrages proposés.
Dans les colonies, ces usages nombreux en font un génie réclamé. Les premiers artisans arrivent avec l’armée XVIIIe, pour la construction des places fortes du territoire. Ces travailleurs, en provenance de la côte Atlantique, s’installent parfois durablement sur les îles et diffusent leurs savoirs des ouvriers locaux, dont des esclaves. Plus tard, au XIXe siècle, en élargissant aux fondeurs et aux chaudronniers les besoins ne manquent pas, accrochés aux rails, aux colonnes, aux lignes mécaniques et vapeurs dans le milieu industriel de la canne en volume.
Les archives sont peu prolixes quant au développement de la ferronnerie, mais donnent à voir son établissement pérenne, là où la nécessité l’appelle : en 1846, une fonderie de cuivre est montée au Vauclin, une forge à hauts fourneaux à Trinité. Plus tôt, en 1830, on retrouve les traces d’une transaction impliquant un four dans le quartier foyalais du Carénage, qui tourne grâce à des esclaves-forgerons, et d’un autre à Pointe-à-Pitre, tenu par un artisan « libre de couleur ».
Des usages illimités
Le ferronnier continue son labeur vers l’art plus fin, délicat et consommé du fer forgé. La révolution des matériaux touche aussi, en cette fin XIXe, l’architecture, les goûts et l’urbain. Là où le feu dévore le bois et traumatise les planificateurs, les structures métalliques s’épanouissent : à Fort-de-France, le marché couvert, la cathédrale Saint-Louis, la bibliothèque Schoelcher font la part belle à l’élégance aérienne des volutes tournées. La particularité de ces éléments érigés en Martinique, c’est qu’ils le sont souvent sur plan, laissant l’interprétation du détail des finitions à l’envie et aux savoir-faire des ferronniers locaux.
Les styles sont ainsi uniques, à la confluence des différentes modes, techniques et compétences qui se répandent sur l’île depuis les régions d’origine de leurs promoteurs. Les propriétaires privés ne se font pas prier pour en adopter les codes et les valeurs. En découvrant les centres préservés des bourgs de la Guadeloupe ou de la Martinique, le flâneur se verra récompensé d’ornementations fort inspirées. Les balustrades des traditionnels vérandas, balcons et galeries adressent la rue avec autant d’exubérance que d’originalité, où chaque artisan aura, à l’envie, reproduit les procédés, motifs et variétés de feuilles, de flammes et d’enroulement qui diffusent localement.
De l’industrie à l’ouvrage d’art
Des pratiques d’artisans anciens, celui de ferronnier est l’un de ceux qui auront survécu aux affres du temps. Largement modernisé, le métier emprunte cependant toujours plus à l’ingénierie et la production de masse. Concurrencé par les modèles moins originaux de cette l’industrie à la chaîne, ces artisans fins font de plus en plus évoluer leur travail vers celui de la création et de l’audace. Face à une demande croissante en savoir-faire local et les enjeux de la restauration du patrimoine, il est fort à parier que le métier, pour corrodé qu’il puisse paraître, saura encore trouver de la ressource.

Texte : Corinne Daunar. Crédit photos : Jean Luc Toussaint / Corinne Daunar